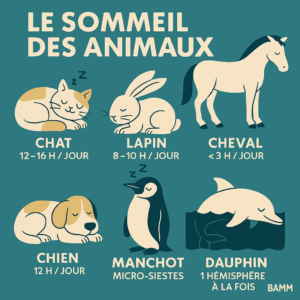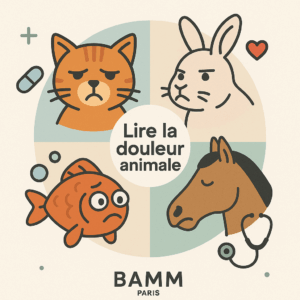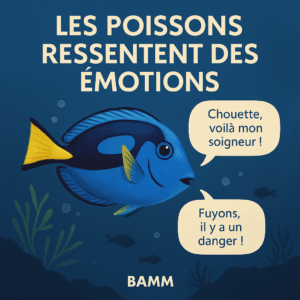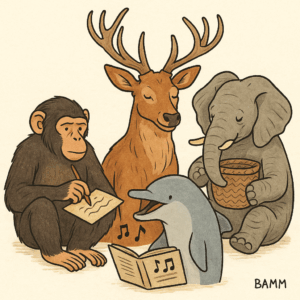Le gène de la domestication
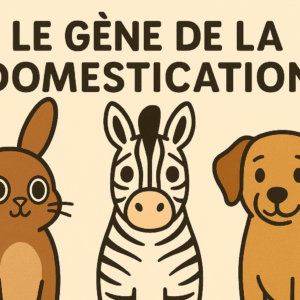
🧬 Et si les chiens, les chats, les lapins (et nous ?) étaient tous un peu sélectionnés pour leur gentillesse ? 🧬
I. La domestication, c’est quoi exactement ?
Quand on parle de “domestication”, on n’évoque pas seulement le fait de vivre avec l’humain.
Un animal domestique n’est pas juste apprivoisé : il est génétiquement modifié (par sélection), génération après génération, pour mieux vivre à nos côtés.
Mais ce que l’on a découvert récemment, c’est que cette transformation ne touche pas uniquement le comportement. Elle touche aussi :
- la forme du crâne,
- la taille du cerveau,
- la couleur du pelage,
- la taille des dents,
- la reproduction…
Et tout cela pourrait bien avoir une origine génétique commune.
II. Le “syndrome de domestication” : une idée qui secoue les cages
Ce que les chercheurs ont observé, c’est que les espèces domestiquées présentent toutes des changements similaires, qu’il s’agisse de chiens, de cochons, de lapins, de chevaux, ou même de canards.
C’est ce qu’on appelle le syndrome de domestication.
Les traits qu’on retrouve souvent :
- une réduction de l’agressivité,
- des oreilles tombantes,
- des taches blanches,
- une queue enroulée,
- une maturité sexuelle plus précoce,
- une docilité accrue.
Pourquoi ? Parce qu’en sélectionnant les individus les plus faciles à vivre, on a sans le vouloir sélectionné aussi un ensemble de traits physiques et neurologiques.
III. Le cas des renards russes : l’expérience qui change tout
C’est dans les années 1950 que le généticien soviétique Dmitri Beliaïev lance une expérience qui va devenir légendaire.
👉 Il sélectionne, parmi des renards d’élevage, ceux qui sont les plus dociles envers les humains.
En quelques générations seulement :
- les renards deviennent câlins, joueurs, obéissants,
- leurs oreilles commencent à tomber,
- leur pelage se macle de blanc,
- leur cortex préfrontal change légèrement de forme,
- leur cycle hormonal s’adapte.
Et tout cela sans que personne ne sélectionne consciemment ces traits-là.
La seule sélection porte sur… la gentillesse.
IV. Mais c’est quoi, ce “gène” de la domestication ?
Spoiler : il n’y a pas un gène unique.
Il s’agit plutôt d’un ensemble de gènes, agissant notamment sur :
- les cellules de la crête neurale embryonnaire, qui donnent naissance à plein de tissus différents (mélanocytes, cartilage, système nerveux…) ;
- la production d’hormones du stress (cortisol, adrénaline) ;
- la sensibilité aux neuromodulateurs sociaux (sérotonine, ocytocine…).
L’hypothèse la plus solide aujourd’hui est celle de la crête neurale atténuée :
en sélectionnant des animaux moins craintifs et plus sociables, on réduit l’activité de certaines cellules embryonnaires… ce qui affecte aussi le pelage, le cartilage, le comportement et même les traits du visage.
IV bis. Toutes les espèces peuvent-elles être domestiquées ? Et bien non.
On parle souvent du “gène de la domestication” comme d’un interrupteur qu’il suffirait d’activer… mais la réalité est bien plus complexe. Toutes les espèces n’ont pas les mêmes cartes génétiques en main.
Certains animaux ne sont pas domestiquables.
Prenons un exemple célèbre : le zèbre.
Malgré des tentatives anciennes pour en faire une monture (notamment par les colons européens en Afrique), aucune domestication durable n’a été possible. Pourquoi ?
- Parce que le zèbre est naturellement territorial,
- Très sensible au stress,
- Doté d’un comportement fuyant et agressif en cas de contrainte,
- Et surtout : il n’a pas le profil génétique favorable que possèdent certaines espèces.
Ce n’est pas une question de “mauvais caractère” : c’est une absence de prédispositions génétiques à la plasticité comportementale nécessaire à la cohabitation.
Des gènes, oui… mais pas chez tout le monde.
Chez les chiens, certains gènes comme WBSCR17 (associé à la sociabilité extrême, une forme de “syndrome de Williams” canin) ont été mis en évidence.
Mais ces gènes, ou leur expression, sont absents ou différents chez d’autres espèces plus “sauvages”.
C’est pour cela que certains animaux s’apprivoisent mais ne se domestiquent jamais :
ils peuvent apprendre à tolérer l’humain, mais leur génome ne peut pas être sélectionné efficacement pour des traits doux et stables.
V. Ce que ça implique pour nos compagnons (et pour nous)
🐶 Les chiens, par rapport aux loups, ont :
- un cortex moins développé pour la peur,
- des réactions sociales plus souples,
- une capacité accrue à lire les émotions humaines,
- et une dépendance plus forte à la présence d’un “allié”.
🐰 Les lapins domestiques, par rapport aux lapins sauvages, montrent :
- une réduction du volume de l’amygdale,
- une moindre réactivité au stress,
- une tolérance au contact prolongé,
- et… des taches blanches sur le front.
🐱 Les chats domestiques, quant à eux, ont coévolué avec nous sans domestication stricte (on parle parfois de semi-domestication), mais ils montrent aussi des traits convergents :
- vocalisations plus nombreuses,
- comportements néoténiques (comme les chatons),
- et stratégies de manipulation douces (cf. notre article précédent 😼).
Mais ce qui est fascinant, c’est que l’humain pourrait lui aussi avoir été “domestiqué”… par lui-même.
VI. Homo sapiens : auto-domestiqué ?
Certaines études en anthropologie et en génétique (notamment par Richard Wrangham) suggèrent que l’humain moderne, par rapport à l’Homo neanderthalensis, présente les mêmes signes que les animaux domestiques :
- crâne plus arrondi,
- mâchoire plus courte,
- agressivité réduite,
- développement social plus complexe.
👉 L’idée serait que notre espèce aurait, au fil des millénaires, favorisé la coopération… et donc auto-sélectionné les individus les plus doux et les plus tolérants.
En gros, nous sommes peut-être les chiens de nous-mêmes.
VII. Conclusion
Il n’existe pas un “gène de la domestication”, comme un interrupteur magique.
Mais il existe un ensemble de mécanismes biologiques et génétiques qui se mettent en place quand l’humain choisit, génération après génération, les animaux “les plus sympas”.
Et ce processus, en modifiant le cerveau, modifie aussi la relation.
Les animaux domestiques nous aiment, oui.
Mais ils sont aussi faits (génétiquement, cérébralement, émotionnellement)… pour ça.
Et si ça vous brise un peu le cœur, sachez que vous aussi, vous avez probablement été sélectionné pour être doux, social, coopératif…
… et légèrement manipulable.
🔬 Sources scientifiques
- Wilkins, A. S., Wrangham, R. W., & Fitch, W. T. (2014). The “Domestication Syndrome” in Mammals: A Unified Explanation Based on Neural Crest Cell Behavior and Genetics. Genetics, 197(3), 795–808.
- Trut, L., Oskina, I., & Kharlamova, A. (2009). Animal evolution during domestication: the domesticated fox as a model. BioEssays, 31(3), 349–360.
- Sánchez-Villagra, M. R., Geiger, M., & Schneider, R. A. (2016). The taming of the neural crest: a developmental perspective on the origins of morphological covariation in domesticated mammals. Royal Society Open Science, 3(6), 160107.
- Hare, B., & Tomasello, M. (2005). Human-like social skills in dogs? Trends in Cognitive Sciences, 9(9), 439–444.
- Wrangham, R. (2019). The Goodness Paradox: The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution. Pantheon.