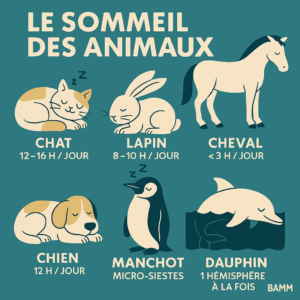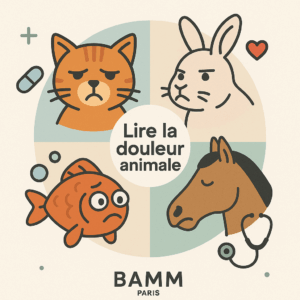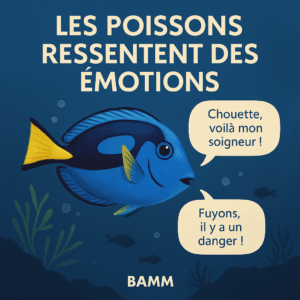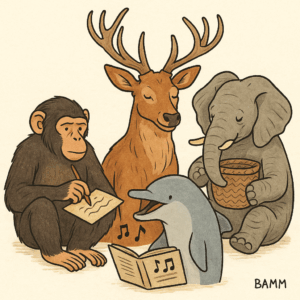Comment l’humain a créé les couleurs chez le lapin domestique ?

Les lapins sauvages (Oryctolagus cuniculus), à l’origine de tous les lapins domestiques, présentaient uniquement un pelage brun-gris, appelé agouti. Cette couleur, issue de la sélection naturelle, leur offrait un camouflage efficace contre les prédateurs. Cependant, au fil de la domestication, des mutations génétiques spontanées ont modifié les gènes responsables du pelage, donnant naissance à des variations de couleurs et de motifs. Ces mutations, rares et souvent invisibles dans la nature, ont été repérées par les humains, puis volontairement amplifiées par la sélection artificielle. Voici comment ces couleurs sont apparues et se sont répandues.
1. Les mutations génétiques : le moteur des nouvelles couleurs
Les couleurs et motifs du pelage chez les lapins sont contrôlés par plusieurs gènes majeurs, chacun jouant un rôle précis dans la production et la distribution des pigments. Les mutations qui affectent ces gènes modifient la couleur ou la structure du pelage.
Comment apparaissent ces mutations ?
- Mutations aléatoires : Les erreurs lors de la copie de l’ADN au cours de la reproduction ou des influences environnementales (radiations naturelles, agents chimiques) peuvent provoquer des modifications dans les gènes.
- Recombinaison génétique : Lors de la reproduction, la combinaison de deux patrimoines génétiques peut entraîner l’apparition de caractéristiques rares.
Ces mutations sont extrêmement rares dans la nature, car les individus ayant des couleurs non adaptées (comme le blanc ou le noir pur) sont facilement repérés par les prédateurs et éliminés par sélection naturelle. En revanche, en captivité, ces mutations sont conservées, car les humains protègent les individus porteurs.
2. Les premières couleurs apparues : albinos, noir et blanc
Les premières mutations de couleur observées chez les lapins domestiques étaient liées à des changements dans les gènes suivants :
Le gène C (Couleur) et l’albinisme
- Le gène C contrôle la production de pigments dans le pelage. Une mutation récessive (cᵃ) empêche totalement la production de mélanine, produisant un lapin albinos (blanc avec des yeux rouges).
- Comment est-elle apparue ? L’albinisme résulte d’une mutation aléatoire dans le gène C, probablement survenue dans une colonie protégée des prédateurs. Les moines médiévaux élevant des lapins pour la viande et la fourrure ont repéré cette couleur rare, l’associant à une certaine pureté ou beauté, et ont sélectionné ces individus pour la reproduction.
Le gène A (Agouti) et le pelage uni
- Chez les lapins sauvages, le gène A favorise la distribution de pigments alternés (agouti). Une mutation récessive (a) inhibe ce mécanisme, produisant un pelage uni (tout noir ou tout marron).
- Comment est-elle apparue ? Cette mutation aurait été repérée dans des colonies où les lapins n’étaient pas soumis à une pression de sélection naturelle. Les humains, intrigués par ces lapins noirs ou marrons, les ont isolés et reproduits intentionnellement pour fixer cette caractéristique.
3. La sélection humaine : amplifier et diversifier les mutations
Une fois que des mutations comme l’albinisme ou le pelage uni étaient repérées, les humains intervenaient pour les amplifier. Cela s’est fait de deux manières principales :
1. Sélection par reproduction dirigée
Les éleveurs sélectionnaient les lapins présentant les couleurs ou motifs recherchés et les faisaient se reproduire entre eux.
- Exemple : Si un lapin noir naissait dans une portée, il était accouplé avec un autre porteur de la mutation, augmentant ainsi les chances de produire d’autres lapins noirs.
2. Introduction de croisements ciblés
Les croisements entre individus porteurs de différentes mutations ont permis de combiner des traits génétiques.
- Exemple : En croisant un lapin noir uni (aa) avec un albinos (cᵃcᵃ), on pouvait obtenir des descendants portant à la fois le gène récessif pour le noir et celui pour l’albinisme.
4. Élargissement de la palette de couleurs : les dilutions et motifs
Au fil du temps, d’autres mutations ont enrichi la diversité des pelages.
Le gène D (Dilution)
Une mutation dans ce gène réduit l’intensité des pigments, créant des couleurs plus claires comme le bleu (dilué du noir) ou le lilas (dilué du chocolat).
- Comment est-elle apparue ? Cette mutation spontanée a été repérée par des éleveurs au XVIIIe siècle et sélectionnée pour sa rareté. Aujourd’hui, les lapins “bleus” sont très prisés.
Le gène E (Extension)
Une mutation du gène E étend ou réduit la production de pigments foncés, permettant l’apparition de lapins aux couleurs fauves, sable ou crème.
- Exemple : Le célèbre lapin “orange”, introduit en Europe au XIXe siècle, est le résultat de cette mutation.
Les motifs complexes
- Lapins tachetés (gène Sp) : Une mutation partielle dans le gène responsable du motif “Hollandais” produit des lapins avec des zones blanches et colorées.
- Lapins himalayens (gène ch) : Cette mutation rend le pelage blanc avec des extrémités foncées, un motif créé par une sensibilité au froid.
5. La fixation des races et la standardisation des couleurs
Au XIXe siècle, les expositions animales et la création de races standardisées ont accéléré la diversification des couleurs. Les éleveurs ont cherché à fixer des combinaisons de couleurs spécifiques pour répondre à des critères esthétiques.
- Aujourd’hui, l’ARBA (American Rabbit Breeders Association) reconnaît plus de 50 couleurs et motifs différents répartis sur plus de 100 races de lapins domestiques.
Les couleurs chez le lapin domestique sont le fruit de mutations génétiques spontanées, rendues possibles par la protection humaine contre la sélection naturelle. La sélection artificielle a amplifié et combiné ces mutations, produisant une incroyable diversité de pelages. Ce processus, qui repose sur des mécanismes biologiques naturels, démontre l’impact de l’homme sur l’évolution des espèces qu’il domestique.
Ainsi, chaque lapin noir, bleu, ou himalayen que nous admirons aujourd’hui est le résultat d’un long processus de mutations rares, soigneusement cultivées par des générations d’éleveurs fascinés par la beauté et la diversité du vivant.