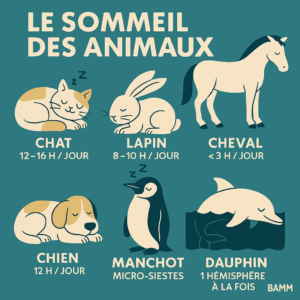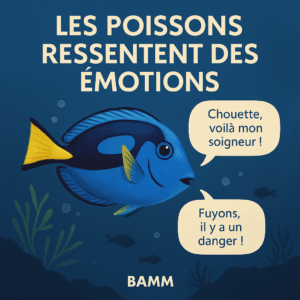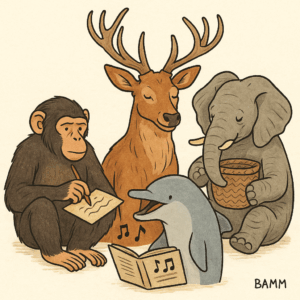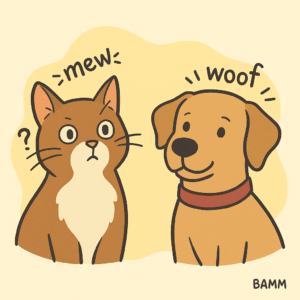La douleur animale : un langage universel qu’il faut apprendre à lire
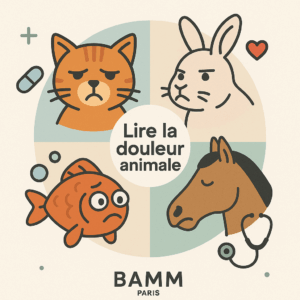
I. La douleur : une fonction biologique universelle
La douleur n’est pas un “caprice humain”. C’est une fonction biologique universelle chez les vertébrés. Tous partagent des nocicepteurs : des neurones spécialisés qui détectent les lésions ou les menaces de lésion (coupure, brûlure, inflammation). Ces signaux remontent au système nerveux central, déclenchant à la fois des réflexes (fuite, immobilité, protection) et des états émotionnels négatifs (souffrance, peur, évitement).
On distingue :
- la douleur aiguë, brutale et localisée, qui sert d’alarme immédiate (le chien qui boite parce qu’il s’est tordu une patte),
- la douleur chronique, insidieuse, souvent sous-estimée, qui altère le comportement au quotidien (le chat arthrosique qui ne saute plus mais ne “pleure” pas).
Évolutivement, ressentir la douleur est un avantage : un animal qui l’intègre évite de reproduire le danger. Ne pas avoir mal, c’est mourir vite.
II. Pourquoi on a si longtemps nié la douleur animale
Du XVIIe siècle jusqu’au XXe, une idée domine : l’animal est une machine. Pour Descartes, un chien qui hurle n’exprime rien : ce n’est qu’un rouage qui grince. Ce dogme a contaminé la médecine, la recherche et les pratiques vétérinaires.
Encore dans les années 1980, des manuels enseignaient que les lapins “ne ressentent pas vraiment la douleur” et que les poissons “n’ont pas le système nerveux pour”.
Pourquoi ? Parce que nous cherchions nos propres codes humains : larmes, cris, mots. Quand ils ne sont pas là, nous concluons “il ne souffre pas”. C’est ce qu’on appelle l’anthropomorphisme inversé : projeter nos attentes, et nier tout ce qui ne les confirme.
Résultat : on a pratiqué des chirurgies sans analgésie, on a laissé des chevaux ulcéreux travailler, et on a cru qu’un lapin immobile était “calme”. (ceci dit on a également longtemps opéré sans anesthésie des nourrissons sur les mêmes motifs)
III. Comment les espèces expriment la douleur
🐶🐱 Chiens et chats : la douleur qui se cache derrière l’habitude
Un chien douloureux ne pleure pas forcément. Il dort plus, refuse de jouer, s’énerve pour un rien, hésite à sauter. Un chat douloureux se replie, plisse les yeux, garde la tête basse. Leurs signaux sont subtils, et l’humain pressé les interprète comme du “caractère”.
👉 Et n’oublions pas une évidence souvent balayée trop vite : si une chirurgie est très douloureuse pour nous, elle l’est aussi pour eux. Chez un humain, une hystérectomie ou une chirurgie abdominale nécessite plusieurs jours d’hospitalisation et une prise en charge lourde de la douleur. Chez un chat ou un chien, l’équivalent (stérilisation, laparotomie) est parfois suivi d’une analgésie minimale et d’un retour à la maison dans la journée. La biologie est la même : douleur abdominale, section de tissus, inflammation. La différence, c’est que nous savons dire “j’ai mal” — eux, non.
🐇🐹 Lapins et rongeurs : champions du silence
Dans la nature, un lapin qui montre sa douleur attire immédiatement un prédateur. Leur stratégie : ne rien montrer. Conséquence : quand vous voyez un signe (immobilité, perte d’appétit, isolement), c’est que la douleur est déjà sévère.
Là encore, le parallèle avec l’humain est éclairant : si une extraction dentaire ou une fracture sont extrêmement douloureuses pour nous, elles le sont aussi pour un lapin ou un cobaye. La différence, c’est que lui restera immobile dans son coin, “calme” en apparence, alors qu’il est en pleine souffrance.
🐎 Chevaux : noblesse stoïque, douleur incomprise
Un cheval douloureux contracte ses muscles, plaque ses oreilles, plisse ses yeux, dilate ses naseaux. Mais trop souvent, on y voit de la “paresse” ou de la “mauvaise volonté”.
Un cheval avec coliques, par exemple, peut être comparé à un humain souffrant d’occlusion intestinale. Chez nous, hospitalisation immédiate et morphine. Chez lui, on hésite encore parfois à administrer des analgésiques puissants, de peur de “masquer les signes”. C’est pourtant la même douleur viscérale, atroce.
🐠 Poissons : douleur sous les écailles
Les poissons possèdent des nocicepteurs et modifient durablement leur comportement en cas de douleur : refus de manger, nage altérée, frottements. Les travaux de Lynne Sneddon (2003) sur les truites l’ont démontré scientifiquement.
⚠️ Ces expériences étaient cruelles (injections acides, absence d’analgésie). Elles ont produit des preuves irréfutables, mais à un coût éthique que nous condamnons.
IV. Pourquoi nous ne la voyons pas : nos biais
Nous associons douleur à cris, pleurs, grimaces humaines. Quand l’animal ne les fournit pas, nous concluons à tort qu’il ne souffre pas.
Nous avons aussi une culture de la minimisation :
– un cheval qui refuse un obstacle = “caractère”, pas ulcère,
– un lapin immobile = “calme”, pas douleur,
– un chat isolé = “grognon”, pas arthrosique.
V. Les grimace scales : lire la douleur sur les visages
Face à ces biais, la science a créé des outils objectifs : les grimace scales. Ces grilles codent la douleur à partir de micro-expressions faciales. Chaque indice est noté de 0 (absent) à 2 (marqué), et le score total indique l’intensité de la douleur.
🐱 La Feline Grimace Scale (FGS) – Evangelista et al., 2019
5 indices à observer :
- Oreilles : droites (0) → tournées (1) → aplaties (2).
- Yeux : ouverts (0) → mi-clos (1) → plissés (2).
- Museau : détendu (0) → allongé (1) → pointu et tendu (2).
- Moustaches : détendues (0) → semi-rigides (1) → rigides, vers l’avant (2).
- Tête : neutre (0) → légèrement basse (1) → très basse/rentrée (2).
👉 Score : 0-2 = pas de douleur ; 3-5 = modérée ; 6-10 = sévère.
Exemple : un chat stérilisé mange normalement. Mais oreilles aplaties (2) + yeux plissés (2) + tête basse (2) = 6 → douleur sévère. Rappelons-le : une stérilisation est une chirurgie abdominale. Chez nous, une hystérectomie n’autorise pas un retour au bureau le lendemain. Chez eux non plus, sauf que l’absence de plainte ne doit jamais être confondue avec une absence de douleur.
🐶 Le chien : Glasgow Composite Pain Scale (CMPS-SF)
Pas uniquement faciale, mais comportementale et faciale.
Indices :
– expression (regard, oreilles, babines),
– posture,
– réactions au toucher,
– vocalisations.
Score total → seuil d’analgésie.
Exemple : un chien arthrosique se lève lentement, détourne la tête, oreilles basses, pas de cris → douleur identifiée par la grille.
🐇 La Rabbit Grimace Scale (RbtGS) – Keating et al., 2012
5 indices :
- Yeux : ouverts (0) → mi-clos (1) → plissés (2).
- Joues : détendues (0) → légers creux (1) → contractées (2).
- Museau : arrondi (0) → allongé (1) → pointu (2).
- Moustaches : détendues (0) → semi-rigides (1) → contractées (2).
- Oreilles : mobiles (0) → rigides (1) → plaquées (2).
Exemple : un lapin post-opératoire immobile semble “calme”. Mais yeux plissés (2) + museau allongé (2) + oreilles rigides (2) = 6 → douleur sévère.
🐭🐹 Souris et rats : MGS et RGS – Langford 2010, Sotocinal 2011
Indices : orbites plissées, joues tendues, nez bombé, oreilles rabattues, moustaches rigides.
Ces outils ont révolutionné la recherche : on ne peut plus dire “immobile = calme”. Mais rappelons-le : ils ont souvent été développés dans des contextes d’expérimentations douloureuses. Nous saluons l’apport scientifique, mais condamnons la méthode.
🐎 La Horse Grimace Scale (HGS) – Dalla Costa et al., 2014
5 indices :
- Oreilles : droites (0) → semi-tournées (1) → plaquées (2).
- Yeux : ouverts (0) → mi-clos (1) → serrés (2).
- Narines : normales (0) → dilatées (1) → très dilatées (2).
- Mâchoire / lèvres : détendues (0) → contractées (1) → serrées (2).
- Muscles de mastication : détendus (0) → visibles (1) → très tendus (2).
Exemple : un cheval colique debout et silencieux. Mais yeux serrés (2) + narines dilatées (2) + mâchoire contractée (2) = 6 → douleur sévère.
🐠 Les poissons : pas de grimace scale, mais des signaux clairs
Impossible de coder une expression faciale. Mais on sait que :
– nage altérée,
– frottements répétés,
– isolement,
– refus d’alimentation
sont des signaux de douleur.
VI. Pourquoi ça change tout
Avant : on jugeait au “feeling”. Aujourd’hui : on mesure. Ces échelles ont transformé la pratique vétérinaire :
– Les chats douloureux ne sont plus vus comme “grognons”.
– Les lapins immobiles ne sont plus “calmes”.
– Les chevaux paresseux ne sont plus “caractériels”.
Et surtout : elles rappellent une vérité simple et percutante : si une intervention est reconnue comme très douloureuse chez nous, elle l’est aussi chez eux. La différence n’est pas biologique, elle est culturelle et médicale. Là où l’humain bénéficie d’un arsenal analgésique complet, nos animaux doivent encore trop souvent se contenter du minimum.
Combien d’entre nous ont déjà entendu : “ne vous en faites pas les anti-douleurs injectés en post-op agissent 24h, ça suffira.” Dites cela à un gestionnaire de la douleur dans un hôpital humain et vous le verrez s’effondrer effaré.
Conclusion BAMM
La douleur animale est universelle, mais chaque espèce a son dialecte. Ne pas l’entendre n’est pas une preuve qu’elle n’existe pas : c’est une preuve que nous ne savons pas écouter.
La science nous donne désormais des dictionnaires : grimace scales, grilles comportementales, outils objectifs. À nous de les apprendre et de les utiliser. Parce que soulager la douleur, ce n’est pas un luxe : c’est la première des obligations envers nos compagnons.
📚 Sources : Evangelista et al. 2019, Holton et al. 2001, Keating et al. 2012, Langford 2010, Sotocinal 2011, Dalla Costa 2014, Sneddon 2003, Braithwaite 2010, Brown 2015.